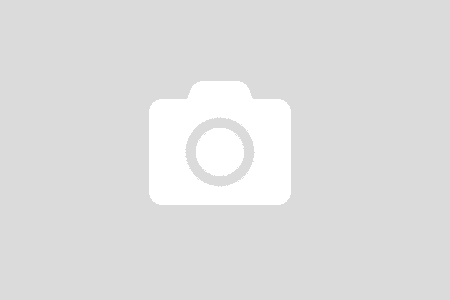Comment réagissez-vous quand quelqu’un vous dit, laissez-moi une minute? Vous roulez des yeux ou vous penchez-vous avec intérêt?
Cette question m’est venue récemment alors que j’essayais de contextualiser un désaccord de longue date entre moi et l’un de mes plus vieux amis. Cet ami aime se moquer de ma préférence pour les œuvres «indulgentes» de conteurs «indulgents», et je ne nierai jamais le goût des œuvres maximalistes, celles qui sont chargées de défauts en raison de leurs ambitions glorieuses. Je ne peux pas nier le risque que je cours en me penchant à plusieurs reprises alors que les artistes adoptent une pure indulgence personnelle; Je sais qu’il y a de bonnes chances que je finisse par inviter un slog regrettable. Mais je sais aussi qu’il y a une chance que je finisse par vivre quelque chose d’extraordinaire. Et nulle part dans mes décennies de fandom cinématographique je n’ai rencontré un cas plus fascinant d’auto-indulgence que le diptyque d’Abre los ojos et Vanilla Sky, deux films identiques dans l’intrigue mais divergents dans l’histoire, l’un raconté et l’autre crié, l’un froid et lointain et l’autre semblant avoir été tourné depuis les profondeurs les plus passionnées de l’âme du réalisateur.
–
Dans les deux cas, nous commençons avec un rêve si peu subtile que même le scénario ne peut pas prétendre qu’il est mystérieux: un homme fabuleusement riche se réveille dans son appartement luxueux, sort du garage souterrain de son immeuble et se rend compte progressivement que la ville est vacante. Lorsqu’il atteint ce qui devrait être le carrefour le plus fréquenté, le vide passe de surprenant à choquant, et il n’a d’autre choix que de sortir et de s’émerveiller devant la métropole non peuplée.
De toute évidence, ce rêve représente la solitude existentielle. C’est la simple conclusion que l’un ou l’autre homme offre à son thérapeute commis par le tribunal, et avec cela réglé, dans aucun des cas l’histoire ne revisite l’image.
Avant cette explication résumée, cependant, ces deux séquences divergent de la manière la plus dramatique. Dans Abre los ojos, la sélection Sundance de 1997 écrite et réalisée par Alejandro Amenábar, la réponse émerveillée du protagoniste à une rue vacante de Madrid est tournée avec une simple grue en recul et un gonflement inquiétant de cordes et de cornes. C’est un moment émouvant, mais qui s’évapore alors que cet homme se réveille et que l’histoire commence sérieusement, son aliénation maintenant fermement établie.
Dans Vanilla Sky, le remake de 2001 de Paramount écrit et réalisé par Cameron Crowe, le protagoniste la réponse émerveillée à un Times Square vacant est marquée par un trip hop tonitruant; plutôt que de simplement reculer, la caméra pivote et pousse tandis que l’écran est simultanément assailli par des aperçus entrecoupés de publicités et de couvertures de magazines. Avant le réveil qui commence l’intrigue, il jette la tête en arrière et écarte les bras, hurlant au ciel alors que la caméra tourne comme un carrousel.

La séquence de Crowe dévore l’oxygène du récit, laissant le spectateur chancelant et pénétrant dans l’histoire un pas derrière le conteur. Non seulement l’image d’un Times Square vacant est époustouflante, non seulement l’exécution cinétique au point de surcharge sensorielle, mais elle soulève des questions extratextuelles. Comment ont-ils fait ça? pour les non-initiés; hey, tu te souviens quand ils ont fait ça? pour tous ceux qui ont suivi le journalisme de divertissement en 2001, lorsque la production de haut niveau est devenue chargée d’intrigues tabloïd. Au cours des deux décennies qui se sont écoulées depuis son tournage, cette ouverture est plus importante que l’histoire qui suit, tirant le spectateur hors de l’expérience avant que l’expérience n’ait une chance de commencer.
Et pourtant, c’est exactement ce déséquilibre qui fait de la cinquième réalisation de Cameron Crowe un objet si fascinant. Vanilla Sky est un film entièrement composé de dissonance, des lacets discordants entre science-fiction cérébrale et humanisme réaliste au tintement des forces de Crowe contre ses faiblesses émergentes. Et bien que cette discordance déconcertante ait longtemps aliéné les téléspectateurs, pour un contingent modeste mais vocal de fans, l’incohérence de la vision suscite l’intrigue, exigeant des visionnements répétés pour résoudre l’équivalent de Cameron Crowe d’une pièce problématique de Shakespeare. « Prelude to a Dream », le film du DVD « Prelude to a Dream », décrit Vanilla Sky comme « un film qui lance une invitation: où que vous souhaitiez le rencontrer, il vous y rencontrera. » C’est une déclaration romantique, mais avec une touche d’équivoque: c’est ce que vous voulez, ne me demandez pas. Les projets Crowe antérieurs pourraient être décrits avec une simple tournure de phrase – Say Anything… et Singles sont tous deux des œuvres riches et idiosyncratiques, mais qui peuvent être facilement classées comme, respectivement, romance pour adolescents et comédie d’ensemble post-graduée. Dans « Prelude to a Dream », cependant, Crowe décrit Vanilla Sky comme « une histoire, un puzzle, un cauchemar, un rêve lucide, une chanson pop psychédélique » et au-delà.Dans une énumération aussi élaborée et contradictoire, on a le sentiment que le cinéaste lui-même a encore du mal à mettre la main sur son propre projet. Vanilla Sky est, en effet, beaucoup de choses, mais surtout, c’est un film en contradiction avec lui-même.
L’arc narratif de Vanilla Sky retrace quelque chose comme la rédemption spirituelle de David Aames, fabuleusement riche, sexuellement vorace, héritier d’édition charmant et narcissique joué par Tom Cruise. Le soir de la fête d’anniversaire de David, il rencontre la scandaleusement charmante Sofia (Penélope Cruz, reprenant son rôle du film d’Amenábar) et les deux partagent une nuit de livre d’histoires de chaste romance avant que David ne soit attiré dans la voiture de son amoureuse instable Julie ( Cameron Diaz), qui pousse un pont dans un accès de jalousie angoissante, se suicidant et détruisant le visage de David. Même la reconstruction chirurgicale laisse les traits de David tellement tordus que les étrangers peuvent à peine établir un contact visuel, son seul recours étant un masque en caoutchouc qui ressemble à un moule à moitié fini pour un costume d’Halloween de Tom Cruise.
L’intrigue de Vanilla Sky est l’intrigue d’Abre los ojos; dans n’importe quel résumé de surface, les noms des personnages de Crowe pourraient être remplacés par ceux d’Amenábar sans qu’une seule nuance ne soit perdue dans le marché. À mi-chemin, cependant, cette fidélité mute soudainement et la structure d’Amenábar devient la toile sur laquelle Crowe superpose un afflux surprenant de vision personnelle brute.
Après une nuit de désespoir ivre, David est ravivé par Sofia et a accordé une nouvelle vie alors que les deux reprennent leur romance tandis que son visage est rapidement réparé chirurgicalement. Ce bonheur, cependant, est interrompu par des épisodes surréalistes dans lesquels Sofia se transforme par intermittence en Julie décédée, conduisant un David frénétique et désorienté à finalement assassiner son amant changeant de forme, le débarquant dans la prison d’où il a raconté l’histoire au tribunal- le thérapeute nommé McCabe (Kurt Russell). Dans l’une de ces fins de choc qui a dominé le tournant du millénaire, il est révélé que le renversement brusque de la fortune de David est le résultat de son inscription à un programme cryogénique qui a généré un rêve lucide fait sur commande dans lequel – comme le programme l’argumentaire de vente explique: «la vie… comme une œuvre d’art réaliste peinte par vous minute par minute». Avec ce gobelet en place, la moitié précédente du film se révèle chargée d’échantillons de la culture populaire, alors que David et Sofia ont reconstitué des moments de la couverture pâmeuse de The Freewheelin ‘Bob Dylan1 au désir romantique de Jules et Jim de Truffaut, avec même McCabe révélé comme une incarnation de ce parangon de la juste décence, la représentation d’Atticus Finch par Gregory Peck.

Cette notion de un paysage de rêve médiatisé est la caractéristique qui distingue le mieux Vanilla Sky d’Abre los ojos, dans lequel le rêve lucide se différencie uniquement par les changements brusques en cauchemar. Mais tout au long, Crowe fait des efforts constants pour aligner le cadre du film d’Amenábar avec Abre los ojos est tout l’intrigue2, un long métrage Twilight Zone existant entièrement en relation avec une révélation choquante et présentant la même caractérisation mince d’autant d’allégories d’une demi-heure de Rod Serling.3 Et Cameron Crowe, à l East avant Vanilla Sky, n’a jamais été un cinéaste pour qui l’intrigue était d’une importance primordiale.
Les meilleurs films de Crowe excellent avant tout comme exemples d’histoire. Dites n’importe quoi… ne perd son pied qu’une fois que l’histoire de la romance de Lloyd et Diane est compliquée par l’injection de complot du troisième acte de la fraude de son père. Quelle petite intrigue pourrait-il y avoir dans Presque célèbre – William peut-il obtenir une entrevue avec le réticent Rusell avant de manquer trop d’école? – tombe secondaire à l’histoire de la découverte de soi sur la route. Le seul antagoniste actif de Jerry Maguire – au moins une fois que le complice Bob Sugar s’estompe à l’arrière-plan après le premier acte – est le pire instinct de Jerry, ce qui donne une histoire de romance et de croissance qui est rafraîchissante et dépourvue de l’intrigue qui a si souvent tourmenté la rom -coms. Avec le temps, ces films Crowe les plus renommés sont devenus plus dans les mémoires pour des moments isolés de personnages que pour des beats narratifs – le bus de tournée chante Almost Famous, un Jerry en sueur et désespéré suppliant son seul client de « Aidez-moi à vous aider! »
C’est là que réside la dissonance la plus significative dans Vanilla Sky, le film problématique de Cameron Crowe: on a demandé à un artiste avec un ensemble de forces très spécifiques4 de faire un film qui semblerait n’en utiliser aucun. Regarder Vanilla Sky en tandem avec Abre los ojos, il est clair que le premier désir de Crowe était d’identifier les lacunes de l’intrigue dans lesquelles il pourrait injecter son style d’histoire, en commençant par dimensionner les personnages intentionnellement minces d’Amenábar.Là où Abre los ojos met en scène un protagoniste chiffré capable de représenter l’archétype inconscient collectif des riches playboys, Crowe prête à David une histoire de famille définie par un père retenu, une histoire qui transcende à peine les tropes des «problèmes de papa» en vertu de quelques coups de pinceau de narration gracieux – son père, David dit à McCabe, « n’a jamais regardé la télévision, et pourtant son plus grand magazine reste le TV Digest », l’un de ces tournures de phrase sans effort qui caractérisent le meilleur de l’écriture de Crowe.
Cette extension de David l’intériorité, cependant, crée des dynamiques qui confondent les objectifs de l’histoire. Crowe, constitutionnellement incapable de raconter l’histoire d’un protagoniste purement cruel, saisit toute occasion possible pour accrocher des qualités ostensiblement rédemptrices à David, créant une traînée sur une histoire conçue pour se déplacer avec une efficacité impitoyable. L’équivalent de Crowe du meilleur ami du chien-pendu unidimensionnel d’Amenábar est le romancier Brian (Jason Lee), que David soutient financièrement pour laisser du temps à son travail créatif. Tout en positionnant théoriquement David comme un mécène des arts et un ami désintéressé, le changement soulève une foule de questions quant à la nature déséquilibrée de cette relation, en particulier une fois que David s’est enfui avec Sofia, que Brian avait amenée à la fête avec ses propres créations romantiques. C’est une chose de voir un personnage accepter qu’il a été battu au niveau du charme et de la beauté – comme dans le récit d’Amenábar, et comme Crowe semble l’inviter – mais avec le facteur implicite que causer une agitation pourrait détruire le gagne-pain de Brian, le choix de David prend sur un air pénible d’extorsion sexuelle.
Le malaise qui vient de la greffe de récits humanistes sur un complot cérébral atteint son apogée avec Julie, que David considère comme une source de relations sexuelles à la demande tout en omettant de la remarquer clairement attachement émotionnel. Dans Abre los ojos, l’analogue de Julie est la femme fatale ultime, si mince que « unidimensionnel » pourrait être une exagération. Crowe semble s’irritent contre l’idée que tout personnage, même un amant meurtrier, devrait être un simple complot, et alors il accorde à Julie une intériorité visible. Non seulement elle est maintenant une actrice et chanteuse en herbe, mais sa douleur existentielle est positionnée pour une concentration sympathique maximale – dans l’un des moments les plus poignants du film, les yeux de Julie se remplissent de larmes quand elle voit David flirter avec Sofia, même si elle feint la nonchalance quand le couple regarde dans sa direction. «Je pense qu’elle est la fille la plus triste à avoir jamais tenu un martini», soupire Sofia, offrant à Julie plus de considération dans une ligne de dialogue5 qu’Amenábar n’offre à son équivalent dans l’ensemble
Étant donné que l’histoire est liée à l’arc de l’intrigue d’Amenábar, la caractérisation de Julie devient un désordre contradictoire – Crowe inclut consciencieusement des lignes se référant à elle comme une harceleuse et une psychopathe, rendant David insensible au point de monstruosité étant donné la conscience du spectateur de sa vulnérabilité. Toute suggestion selon laquelle cela pourrait être une ride intentionnelle dans la caractérisation de David est jeté dans le désarroi lors de la panne homicide à grande vitesse de Julie, qui – comme l’intégralité de sa fonction d’intrigue – se sent coincée quelque part entre l’hystérie du camp et le portrait sincère de la détresse maniaque. Tandis que Julie hurle: «Lorsque vous couchez avec quelqu’un, votre corps fait une promesse que vous le fassiez ou non», il est impossible de savoir si Crowe le considère comme un truisme urgent ou une preuve supplémentaire d’illusion.

Aussi frustrant que puisse être la narration d’une cohérence discutable de Crowe, elle génère une imprévisibilité souvent palpitante. Quand le froid et minimaliste Abre los ojos prend un virage vers violence hallucinatoire, toute incertitude est purement cérébrale grâce au livre de jeu familier établi par d’autres thrillers contemporains. Vanilla Sky, quant à lui, est imprégné d’autant de désir brut et d’autant de gouttes d’aiguilles pâmantes, que Almost Famous, qui laissent les allusions émergentes de David la violence à venir transportant un sentiment nauséabond de territoire véritablement inconnu. Quand un cinéaste qui trafique dans des ondes écrasantes du cœur – de la sérénade de boombox instantanément iconique de Say Anything… au climactique de Jerry Maguire « You complete me » – taquine l’effusion de sang, t Le risque potentiel pour les sensibilités des téléspectateurs est inhabituellement puissant.
Cette ultime explosion de violence – à mi-coït, Sofia se transforme en Julie, que David étouffe avec un oreiller uniquement pour qu’elle soit remplacée par Sofia post-mortem— est réglé sur les souches hyperboliques psych-rock de « The Porpoise Song » de The Monkees, un choix si perversement spécifique qu’il ne pouvait venir d’aucun autre esprit que celui de Cameron Crowe. S’il y a un sentiment de compromis dans l’adoption par Crowe de l’intrigue d’Amenábar, en échange, il a la possibilité de courir à travers un paysage de rêve culturel illimité, un paysage qu’il accepte avec un abandon joyeux.
Dans l’une de ses myriades de tentatives pour dimensionner David, Crowe le caractérise comme un homme remplissant son vide intérieur avec des médias – nous obtenons de multiples indications que David regarde de vieux films pour s’endormir, jetant les bases de la infusion d’art dans son monde inconscient – et s’il peut être difficile d’envisager ce diletante ostensiblement parasite comme suffisamment émouvant pour être ému par l’image sur un LP de Bob Dylan, prolonger cette suspension de l’incrédulité laisse l’espace pour un acte remarquable de projection de réalisateur .
Cameron Crowe est un homme manifestement consommé par la culture pop. Dans ses mémoires cinématographiques, Almost Famous, William (un personnage identique à Crowe dans tous sauf le nom) est catalysé de l’enfance à l’adolescence au moment où il ouvre une boîte de vinyle rock & roll, tandis que Le critique de rock Lester Bangs (mentor de William dans la fiction et Crowe dans la vie) décrit de manière rhapsodique l’art comme quelque chose qui vit dans «les vastes ponts scéniques et les chœurs angéliques de votre cerveau… un endroit à l’écart du vaste territoire bénin de l’Amérique.» Être fan, annonce un autre personnage plus tard, c’est aimer tellement un « petit » travail stupide « que ça fait mal. »
Dans une chronique d’invité de 2002 pour The Guardian, Crowe décrit David comme « défini, comme beaucoup d’entre nous, par la culture pop », et cite la question essentielle de Vanilla Sky comme:« où commence une vraie vie et où finit la culture pop? » Malgré les affirmations de Crowe, c’est une question beaucoup plus urgente pour le créateur que pour le personnage, et en l’enquêtant, il a fait quelque chose comme extérioriser sa propre intériorité. Crowe évoque un monde d’extase sensorielle qui se conforme à ses propres préférences esthétiques, avec les caractéristiques de la culture pop théoriquement aimées par David étant de manière transparente celles aimées de Crowe; le riff de McCabe sur To Kill a Mockingbird est annoncé dans Presque célèbre lorsque le personnage inspiré de la mère de Crowe félicite son fils pour avoir choisi Atticus Finch comme modèle, tandis que le prisé Townshend de David -la guitare écrasée semblerait un objet d’affection approprié pour l’homme qui a profilé The Who dans sa jeunesse.
Dans les moments les plus bas de la vie de tout obsessionnel de la culture pop, l’idée de s’échapper dans « une œuvre d’art réaliste peint par vous minute par minute »semblerait – eh bien, un rêve devenu réalité. Et Crowe imprègne la moitié arrière de Vanilla Sky avec suffisamment de son propre cœur que lorsque David fait le choix ultime de s’effondrer du gratte-ciel du paysage de rêve et de se réveiller dans la réalité, l’explosion d’images fragmentaires représentant une vie clignotant sous ses yeux est un mélange de celle de David. et Crowe – à côté d’aperçus des événements précédents du film et d’une cascade d’échantillons de culture pop de Townshend à The Red Balloon, nous voyons des photos de Crowe enfant, de sa femme de l’époque Nancy Wilson, des bribes de films de la famille Crowe, et derrière -les scènes de candids de projets Crowe antérieurs, tous fusionnés avec d’autres détritus culturels pour former un portrait en mosaïque du cœur et de l’âme du réalisateur.

Avec les seuls écarts entre le film d’Amenábar et celui de Crowe étant inhabituellement personnel Comme il reflète soit sa sensibilité unique à la narration, soit ses passions les plus profondes, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi la réception largement négative de Vanilla Sky serait exceptionnellement douloureuse. Alors que Rotten Tomatoes est un baromètre certes imparfait, il y a quelque chose de glaçant dans la chute entre les 85% d’approbation critique « certifiée fraîche » accordée à Abre los ojos et les 42% giflés sur Vanilla Sky. « Qui aurait pensé que Cameron Crowe avait un film comme mauvais comme Vanilla Sky en lui? Stephanie Zacharek a réfléchi dans sa critique du Salon, et le phrasé est approprié. Si l’original était bon mais le remake (ostensiblement) mauvais, alors les éléments répréhensibles devaient être ceux en lui. « La vérité épineuse avec laquelle il est le plus difficile de compter », selon Zacharek « est que le plus grand cadeau de Crowe fleurit ici avec autant de luxuriance que dans chacun de ses films précédents – et pour la première fois, c’est complètement inefficace. »
Avec cette déception, Crowe a semblé attraper un cas significatif des yips, ce diagnostic officieux pour un athlète vedette qui perd brusquement la capacité de performer. Après avoir sorti le bien-aimé Almost Famous – pour lequel il a remporté un Oscar du meilleur scénario original – et le diviseur Vanilla Sky au cours des années consécutives, il a attendu quatre ans avant de créer Elizabethtown, un retour au réalisme comique doux qui a été accueilli avec une révulsion quasi universelle6 ; après une absence de six ans, il est revenu avec une adaptation à faible risque et à faible récompense du mémoire bien considéré de Benjamin Mee We Bought a Zoo, 7 et après avoir retrouvé ce terrain modeste aux yeux du public, il est revenu à la narration originale et a produit Aloha, un assemblage pratiquement incompréhensible d’idées disjointes et de tics écrivains.8 Lorsque Steve Blass est passé de lanceur vedette de la candidature de la Série mondiale 1971 des Pirates de Pittsburgh à une moyenne d’un batteur par manche lors de la saison 1973, son entraîneur de lanceurs a déclaré au New Yorker: « Je ne pense pas que quiconque comprendra jamais son déclin », et la chute de Crowe semble également inexplicable.
Il est facile d’imaginer que, consciemment ou non, Crowe pourrait attribuer son schisme de carrière au rejet de Vanilla Sky. Elizabethtown – une autre histoire vaguement calquée sur La propre vie de Crowe, cette fois ses expériences de traitement de la mort de son père – comprend des éléments d’auto-flagellation parodique, le protagoniste ayant récemment vécu son propre fiasco professionnel. « Un échec », précise le remplaçant de Crowe dans le monologue d’ouverture, « est simplement la non-présence du succès… un fiasco est un désastre aux proportions mythiques. Quoi que Crowe puisse croire, cependant, Vanilla Sky n’est pas un fiasco; Box Office Mojo revendique un budget mondial de près de quadrupler le budget, et même dans sa propre critique cinglante pour Time, Richard Corliss était prêt à accorder à Crowe « un raté sauvage sans durée coûté à sa réputation. Il porte cependant les premières idées des faiblesses qui accableraient bientôt ses forces.
Ces angles morts sont souvent bénins, quoique déroutants. Dans l’exemple peut-être le plus flagrant, Sofia et David se lancent le défi de se dessiner mutuellement les faiblesses. La scène est directement recréée d’Abre los ojos, mais là où, dans le récit d’Amenábar, Sofia livre un dessin réaliste d’amateur, dans Crowe, elle révèle une caricature de promenade de qualité professionnelle. Il est difficile d’envisager un tel choix de la conception à l’exécution sans qu’un seul membre d’équipage ne le qualifie de ridicule, mais les images des coulisses suggèrent qu’un équipage retient activement les critiques constructives.

Dans « Prelude to a Dream », un documentariste sur le plateau demande à plusieurs membres d’équipage, lors de la configuration, une image particulièrement obtuse (le sol de l’appartement de David post-accident dans une grille d’innombrables documents), « Que pensez-vous que ce plan signifie? » «C’est déroutant», répond l’un d’eux. «Je ne sais pas», répond un autre. Un troisième décrit le plan en termes littéraux avant que le documentariste ne le pousse de nouveau à en expliquer le sens. « Cameron le sait », répond-il avec un épuisement impassible. Crowe finit par répondre, avec une exubérance ludique, « Il est bourré pour la finale de la vie! » et bien que le succès fulgurant de ses travaux antérieurs puisse naturellement amener les autres à faire confiance à son instinct, la « confiance » ne semble pas le sentiment opératoire de l’équipage de Crowe. Bien que l’inclusion du moment dans une bobine promotionnelle indique un niveau de bonne volonté, il atterrit comme un testament douloureux de la responsabilité qu’un auteur non contrôlé peut prouver à son propre art.
Les premières ondes de choc de la contribution la plus ignominieuse, quoique indirecte, de Crowe au paysage culturel moderne: le trope du lutin maniaque fille de rêve. Ce terme désormais omniprésent a été inventé lorsque le critique Nathan Rabin a estimé que l’intérêt amoureux d’Elizabethtown de Kirsten Dunst représentait une classe de personnages qui «n’existe que dans l’imagination fébrile des scénaristes-réalisateurs sensibles pour apprendre à de jeunes hommes pleins d’âme à embrasser la vie et ses mystères et aventures infinis. Au fur et à mesure que le terme s’est répandu, il est passé d’une simple critique esthétique à un signifiant de problèmes culturels bien plus importants. Dans un essai de 2013, l’auteur Laurie Penny évoque la «douleur aiguë sous la cage thoracique» qu’elle a éprouvée en tant que jeune lectrice lorsqu’elle a remarqué «combien peu de filles pouvaient partir à l’aventure». Avec Elizabethtown, Crowe a créé par inadvertance une plate-forme pour un nouvel examen des dommages causés lorsque les filles sont conditionnées à s’attendre, comme l’écrit Penny, à être des personnages de soutien oubliables, ou parfois, si nous sommes chanceux, des objets atteignables à suspendre sur le l’épaule du héros et emporté la fin de la dernière page. »
Dans le vide, Vanilla Sky pourrait être lu comme réfutant cette envie masculine de voir les femmes comme des sauveuses désintéressées (et libres d’elles-mêmes). David pourrait croire il est charmé par Sofia, mais ce qui lui semble le plus captivé, c’est un mur de photos dans son appartement, des flashs intimes de sa vie – des portraits de famille aux candids semi-nus – qu’elle a assemblé pour son propre plaisir et qu’il peut utiliser comme la base pour extrapoler une existence idéalisée dans laquelle il pourrait s’échapper. « J’aime ta vie », soupire-t-il en examinant cet étalage, ne se laissant pas décourager quand elle répond: « Eh bien, c’est à moi, et tu ne peux pas l’avoir. » La révélation finale que leur romance a été une commission privée synthétique atterrit avec un coup accablant – «Vous la connaissiez à peine dans la vraie vie», se souvient David, et cela résonne comme un avertissement implicite pour tout homme solipsiste qui tombe amoureux du idée d’une femme qui ne lui en veut que d’avoir osé avoir des désirs et des besoins indépendants.
Mais une dernière ride compliquée pointe vers les futures caractérisations problématiques de Crowe: parmi les dernières révélations fournies par le support technique en rêve de David, Edmund Ventura (Noah Taylor), est le fait que dans le monde réel, « Sofia jamais complètement remis »de la perte de David. Immédiatement après avoir mis en garde les hommes contre la fuite dans des fantasmes solitaires, Crowe se livre à ce fantasme hideux selon lequel la perte pourrait affaiblir ceux qui se sentent sous-estimés. D’un conteur auparavant capable de créer des personnages si vivants qu’ils semblent d’exister au-delà des limites de leurs propres films, 9 cela semble être une trahison particulièrement cruelle que Crowe devrait damner Sofia pour ne jamais atteindre le vrai bonheur après une nuit avec un narcissique manipulateur.
Comme tant d’éléments de Vanilla Sky , il est difficile de concilier l’histoire de Sofia. Mais ce sont précisément ces dissonances épineuses qui attirent les partisans du film. C’est peut-être le film problématique de Cameron Crowe, mais les problèmes le font généralement J’ai des solutions, et donc je me retrouve à l’étudier de manière compulsive, et dans le marché, je suis traité avec des notes de grâce classiques de Crowe comme l’étrange danse serpentine dans laquelle David s’introduit brusquement à la fin d’une réunion avec McCabe. Ces moments sont aussi singuliers que n’importe quel fleurissement dans Presque célèbre, mais ils chantent avec une incongruité électrique dans un thriller hallucinatoire. Dans « Prelude to a Dream », Crowe décrit son objectif de créer un film « comme la couverture de Sgt. Pepper – chaque fois que vous le regardez, vous pouvez voir quelque chose de différent », et je dois dire qu’il a réussi. Même après des décennies de réexamen, ce n’est que lors de cette dernière visite que j’ai pleinement absorbé le contraste émouvant entre les plans inhabituellement naturalistes au niveau de la rue du défilé de Thanksgiving de Macy et le même événement vu de l’intérieur de l’appartement sombre dans lequel David se cache après l’accident.

Une énorme fleur de Crowe s’est finalement retrouvée sur le sol de la salle de coupe: dans une fin alternative10, Edmund ressemblant à un sphinx Ventura se lasse de démêler minutieusement la réalité labyrinthique du film à son client et claque: « Je vous ai tout donné! Je vous ai même donné une chanson thème de Paul McCartney, qui est un matériau très difficile à acquérir! »
Le line est un candidat naturel pour l’excision; il n’a aucune fonction d’intrigue, et le concept n’a pratiquement aucun sens dans n’importe quel contexte. C’est un moment de pure indulgence, Crowe clignant de l’œil au coup de grâce qu’il a réalisé en commandant une chanson de générique de fin de temps Beatle. Le choix de perdre le tour de victoire préventif de Ventura semble encore plus prudent étant donné que la chanson de McCartney est extraordinairement stupide, même selon les critères de l’homme qui a écrit « Yellow Submarine ». Moins une chanson qu’une salade de mots mélodiques11, l’œuvre de McCartney témoigne de la difficulté gigantesque de sa mission, qui n’est pas sans rappeler celle de Crowe: il a été inspiré et contraint de travailler à rebours pour appliquer ses talents.
Cela directive, dans le cas de McCartney, était de faire sortir une chanson d’une paire de mots dénués de sens: « ciel vanille ». Crowe se plie en quatre pour incorporer les mots dans le scénario – dans une ligne particulièrement éprouvante pour la crédulité, David montre à Sofia un Monet original, se vantant que le pinceau de l’artiste «a peint le ciel vanille» – et travaille encore plus dur pour le justifier thématiquement en cela Colonne du gardien, où il cite la ressemblance théorique entre le ciel de Monet et le ciel du rêve lucide de David. «D’une manière qu’il n’aurait jamais pu imaginer, ce ciel revient plus tard pour définir qui il est», écrit Crowe, et ainsi le titre représente «un sentiment, un état d’esprit, un rêve d’une vie qui peut ou non exister. » Encore une fois, Crowe tombe dans un dénombrement excessif, mais cette fois, il admet la vérité: « D’accord, j’aime juste la façon dont les mots sonnaient. »
C’est dommage que Crowe se soit senti obligé de lutter contre ses propres pulsions , alourdissant son film de dialogues plombés pour défendre le choix pleinement défendable de titrer un film souvent abstrait avec une phrase abstraite. En réfléchissant trop à son impulsion, il trébucha sur ses propres pieds, et cette perte de flux croissante le condamnerait à un cas de les yips si sévères que seuls ses fans les plus dévoués espèrent encore qu’il se rétablira.12
Peut-être que ma propre dévotion n’est pas assez forte pour maintenir cet espoir. Il est difficile d’imaginer que nous en verrons un autre film aussi parfait que Jerry Maguire ou Almost Famous. Mais si nous avons de la chance, nous pourrions voir un autre film aussi fascinant à l’infini que Vanilla Sky. Crowe a toujours comparé son film à une reprise d’Amenábar, la version punk de la chanson folk d’Amenábar . Mais il me semble que la comparaison la plus appropriée serait qu’Amenábar ‘ Le film dit: «Laissez-moi vous raconter une histoire, tandis que celui de Cameron Crowe dit:« Faites-moi plaisir une minute. Et malgré tous les dégâts avec lesquels je pourrais être obligé de m’emmêler, je continuerai à me pencher en avant avec intérêt.Comme l’artiste en difficulté Brian rappelle si souvent à son patron manipulateur tout au long de l’histoire leur amitié déséquilibrée, la douceur de vivre est toujours plus douce avec un goût déroutant de l’amertume.