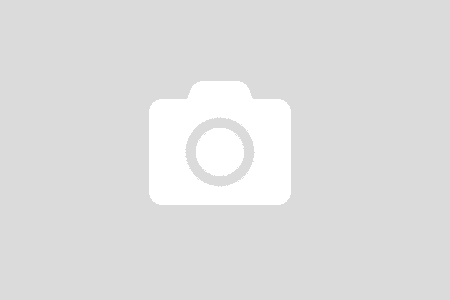Diderot aurait voulu qu’il soit lu de cette façon. Il était en faveur du plaisir et, bien que célèbre comme libertin, il exhortait ses amants à rechercher la satisfaction orgasmique, à reconnaître que leur plaisir lui était autant un plaisir que le sien. Dans une lettre, il a exhorté l’une de ses maîtresses, Sophie Volland, à s’approprier son plaisir, comme on pourrait le dire maintenant: «Puisque le visage d’un homme qui est transporté par l’amour et le plaisir est si beau à voir, et que l’on peut contrôler quand vous voulez avoir cette image tendre et gratifiante devant vous, pourquoi vous refusez-vous ce même plaisir? Il était également en faveur du traitement de l’homosexualité comme un produit normal de la physiologie humaine. «Rien de ce qui existe ne peut être contre nature ou hors de la nature», a-t-il écrit à propos de l’amour homosexuel. L’idée de l’illumination de Diderot incluait la lumière d’un plaisir partagé et ouvert.
Pour tout le plaisir général de leur existence, cependant, chaque fois que les philosophes des Lumières mettent la plume sur papier, ils mettent leur vie et leur liberté en jeu. Comme Curran nous le rappelle constamment, penser avec scepticisme à la vérité de la religion signifiait risquer la prison et la persécution. En 1749, comme punition pour ses pamphlets sceptiques et athées, plus particulièrement pour sa «Lettre aux aveugles» de la même année, un étrange mélange de psychologie perceptive précoce et une polémique contre la superstition chrétienne (les aveugles sont à la fois ceux qui ne peuvent pas voir et ceux qui choisissent de ne pas voir), Diderot a été arrêté et emprisonné, sans procès ni procès, dans le donjon de Vincennes.
La France des Lumières n’était pas la Russie soviétique; les sources de pouvoir étaient dispersées par les caprices du patronage et de la existence d’une aristocratie assez riche pour être, dans certaines limites, indépendante du roi (l’affection de Madame de Pompadour, maîtresse de Louis XV, se révéla plus tard vitale pour la suite de l’Encyclopédie.) Rousseau visita Diderot dans le cachot, et Voltaire, qui avait admiré le pamphlet de Diderot, a fait écrire sa brillante physicienne-maîtresse, la marquise du Châtelet, au nom de Diderot pour un traitement plus gentil.
Pourtant, la menace de l’emprisonnement ou de l’exil n’a jamais complètement cessé. L’Église, à travers ses instruments civiques, a régulièrement emprisonné, menacé et harcelé les partisans du nouvel apprentissage. Ce à quoi Diderot a été confronté n’était pas la désapprobation ennuyeuse ou la tolérance condescendante dont les chrétiens se plaignent maintenant de venir des élites libérales; c’était de la persécution réelle, un désir d’emprisonner les coupables de pensée hérétique, de fermer la bouche et d’éradiquer toute trace de leurs livres.
Pornographe, polémiste, prisonnier d’opinion: ce n’était pas exactement le C.V. on s’attendrait à un éditeur d’encyclopédie. Pourtant, quand, en 1747, Diderot fut approché pour superviser le projet (d’abord pour mettre à jour une encyclopédie anglaise plus ancienne, puis pour en créer une entièrement nouvelle en français), il s’y jeta et persista – face à cette persécution sporadique, contributeurs dilatoires, et le poids même de l’ambition impossible – jusqu’à ce qu’elle soit terminée: quelques dizaines de volumes, avec soixante-douze mille articles et trois mille illustrations, un recueil de toutes les connaissances partout.
L’Encyclopédie est à la fois omniprésent et occulte. C’était un appel à un nouvel apprentissage, accessible à tous, mais maintenant les seules personnes qui peuvent le lire sont des experts de l’Encyclopédie. Curran montre clairement que les longues étendues, en particulier les assiettes magnifiquement rendues, qui célèbrent les technologies et l’artisanat obsolètes, ont maintenant une touche surréaliste d’absence de signification particularisée. En même temps, il nous aide à voir que le projet, loin d’être l’expression d’un renseignement de supervision de type Panopticon ordonnant un monde indiscipliné, est improvisé, follement éclectique et «hyper-lié» dans sa nature même – un ensemble de « des feintes brillantes, de la satire et de l’ironie », comme le caractérise Curran.
Pour se protéger des accusations d’impiété, par exemple, des pièces ont été commandées sur l’histoire biblique à des catholiques pieux. était une entrée longue et sobre sur l’architecture de l’arche de Noé et la logistique de l’entreposage des animaux – dans la confiance que les lecteurs les trouveraient manifestement absurdes. Plus subtilement, comme le soutient Curran, l’insistance de Diderot à organiser l’Encyclopédie par ordre alphabétique «rejetait implicitement la séparation de longue date des valeurs monarchiques, aristocratiques et religieuses de celles associées à la culture bourgeoise et aux métiers du pays. La théologie et la fabrication, les calices et les entraîneurs, devaient coexister dans ses pages, et sur un pied d’égalité. Vous ne saviez jamais où dans le monde vous pouviez plonger, haut ou bas, lorsque vous tourniez la page.
Et le L’Encyclopédie était étrangement capable d’être lue de multiples façons dans de multiples contextes. En collaboration avec le mathématicien et compatriote Jean le Rond d’Alembert, Diderot a ensemencé le texte avec un motif de renvois souvent obscurs, des renvois, conçus pour montrer que l’on sujet d’étude pourrait en conduire un autre de manière surprenante.«A tout moment», expliqua Diderot, «la grammaire peut faire référence à la dialectique; Dialectique à la métaphysique; Métaphysique à la théologie; Théologie à la jurisprudence; Jurisprudence à l’Histoire; Histoire à la géographie et à la chronologie; Chronologie de l’astronomie. . . . » Le système était subtilement directionnel: il montrait comment un sujet pouvait passer de la spéculation à l’expérience, de la métaphysique à l’astronomie. Et pourtant l’Encyclopédie – dont dix-sept volumes avaient paru en 1765, avec de nombreux volumes d’illustrations à suivre – n’a jamais été censée être complète. Il a délibérément lié des articles conflictuels, observe Curran, afin de faire ressortir les crevasses et les contradictions dans la connaissance de l’époque. C’était une invitation à de nouveaux apprentissages, un livre vraiment ouvert.
Curran fait un travail formidable en triant l’histoire follement compliquée de la publication de l’Encyclopédie. À un moment donné, apprend-on, il a été condamné par le Pape comme blasphématoire; quiconque possédait un volume était chargé de le remettre au prêtre local pour qu’il le brûle. Diderot et son équipe ont contourné les interdictions par une danse complexe de légalismes, ce qui leur a permis, par exemple, de continuer à l’imprimer en France tout en le publiant officiellement en Suisse.
Curran présente également un argument solide et convaincant que Louis de Jaucourt, en grande partie oublié, chevalier ou chevalier et médecin en exercice, était principalement responsable de la finition du gros livre; il en produit dix-sept mille articles, gratuitement. Il était aussi l’un des abolitionnistes les plus fervents de la France du XVIIIe siècle, et il apporta cette ferveur aux derniers volumes de l’Encyclopédie. Ouvert, pluraliste, anti-hiérarchique – le document prétendument totalitaire de la pensée absolutiste des Lumières s’avère, dans tous les sens du terme, être un manifeste pour la liberté.
C’était la réputation de Diderot comme l’homme de l’Encyclopédie, cependant, qui a produit l’épisode le plus étrange et le plus coloré de sa vie, quand il a accepté une invitation à se rendre en Russie, en 1773, pour agir comme tuteur, mentor et législateur éclairé de Catherine la Grande. Cet épisode de cinq mois est le seul sujet ostensible du livre de Zaretsky – ostensible parce que Zaretsky profite joyeusement de l’occasion pour écrire une évaluation merveilleusement avisée et savante de l’ensemble de la carrière de Diderot, des Lumières et de la culture russe. C’est un sujet irrésistible, ayant déjà fait l’objet de plusieurs autres investigations, ainsi que d’un roman délicieusement stoppardien de l’écrivain britannique Malcolm Bradbury.
C’était une intersection bizarre. Un ennemi des Lumières du despotisme devient le garçon jouet d’un despote. En vérité, le rêve d’un monarque bienveillant qui refaire le monde d’une manière plus rationnelle en dictant des lois saines à ses compatriotes complaisants est aussi ancien que la Grèce et la légende d’Alexandre instruit par Aristote. Voltaire avait déjà, bien en 1740, entrepris quelque chose de similaire avec Frédéric de Prusse, avec une futilité prévisible.
La tentation de Voltaire par Frédéric est facile à comprendre: l’éloge vous mènerait n’importe où avec Voltaire. Diderot était un homme plus conscient de lui-même, avec lui, l’éloge ne vous mènerait qu’à peu près n’importe où. L’engagement de Voltaire avec Frederick était une descente d’un engouement partagé vers un dégoût mutuel. L’engagement de Diderot avec Catherine – c’est l’aspect que Bradbury saisit bien – était marqué par des demi-pas, des hésitations, des côtés ironiques, une connaissance de soi omniprésente. Il était sur son jeu, et elle, étonnamment, était sur la sienne.
Comme Zaretsky éclaire brillamment dans une discussion sur la « géographie philosophique de l’époque, »Diderot a compris que ce que voulait Catherine, sur les traces de Pierre le Grand, était d ‘« européaniser »la Russie, tandis que ce que les Européens, dont Diderot, voulaient, c’était exotiser la Russie. Il voulait une Russie étrange – une nouvelle Sparte ou un Byzance toujours en plein essor – pour la rendre belle. De plus, si la Russie était suffisamment étrangère, l’enquête morale pourrait être mise entre crochets pendant la durée de son séjour. Un serf ici et là n’a pas obscurci le tableau essentiellement positif.
Catherine s’en sort extrêmement bien dans le récit de Zaretsky. Adolescente, une Allemande emmenée dans une cour russe arriérée – dans l’un de ces mariages forcés pratiqués régulièrement parmi la royauté de l’époque – elle était naturellement désespérée pour une petite vie d’esprit. Elle avait atterri en plein milieu d’un ménage bizarre, une sorte de court « Game of Thrones », avec son propre mari, le futur tsar, comme le Joffrey de Russie, mentalement (et, semble-t-il, sexuellement) prince handicapé dont le seul plaisir était de jouer avec les soldats de plomb qu’il tenait au lit.Elle a raisonnablement pris une série d’amoureux et a produit avec eux des pseudo-héritiers royaux, que sa belle-mère formidablement pragmatique, la fille de Pierre le Grand, a élevée comme la sienne.
C’était une guerre dynastique brutale, des gènes récessifs et des familles rivales (son mari n’a régné que six mois, en 1762, avant de mourir dans des circonstances troubles), à une seule exception cruciale: Catherine avait des motifs véritablement altruistes pour accompagner ses ambitions dynastiques. Ayant lu Montesquieu – en fait, ayant ouvertement copié de lui dans son propre projet de constitution russe, la soi-disant Nakaz – elle en était venue à croire à l’idée d’un meilleur gouvernement et de lois plus justes et même à l’idée d’un gouvernement par consentement. des gouvernés. Diderot était son homme pour faire passer l’heure. Lorsqu’il a admiré l’étendue de son apprentissage, elle a répondu: «Je dois cela aux deux excellents professeurs que j’avais depuis vingt ans: le malheur et l’isolement.»
Diderot pensait que la seule façon de traiter une reine était en femme – notion qu’il semble parfois avoir portée au bord du danger. Catherine semble d’abord avoir été amusée, puis agacée, par ses familiarités: «Je ne peux sortir de mes conversations avec lui sans avoir mes cuisses étaient bleues et noires. J’ai été obligé de mettre une table entre lui et moi pour me garder moi-même et mes membres hors de portée de ses gesticulations. La saisie semble avoir été simplement une expression d’enthousiasme: il était l’un de ces causeurs animés – Leonard Bernstein me vient à l’esprit – qui ne pouvait pas croire que vous l’aviez vraiment eu à moins qu’il ne vous comprenne vraiment.