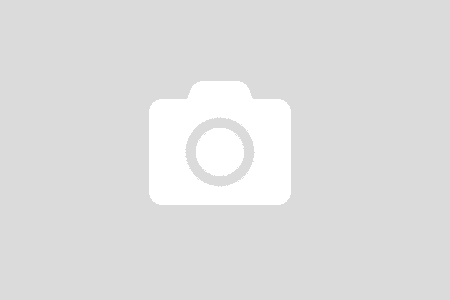Si les bourreaux du troisième mai sont terrifiants parce que Goya nous en montre très peu, ses victimes sont inoubliables car on en voit tellement. Les historiens de l’art ont renversé des océans d’encre en analysant la «figure de martyr» en chemise blanche et aux yeux écarquillés, comme on l’appelle souvent (et à tort). Dans sa superbe biographie de Goya, le critique Robert Hughes décrit cette figure comme «une des «présences» humaines les plus vives de tout art », tandis que d’autres ont comparé sa pose à celle du Christ sur la croix. Regardez attentivement, en fait, et vous trouverez des blessures sur les mains de l’homme, une allusion sans équivoque aux stigmates du Christ. Pourtant, Goya ne laisse jamais ces allusions entraîner sa peinture dans la sentimentalité. Cet homme est une victime, mais pas tout à fait un martyr. Il n’a pas choisi de mourir, encore moins de mourir pour une cause; en jetant les mains, le front contracté de terreur, il ne représente ni plus ni moins que lui-même. Sa mort est crue, incompréhensible, exaspérante – aucune religion ni aucun patriotisme ringard ne peuvent l’expliquer. Comme l’a dit Hughes, « Il n’y a pas de design supérieur: seule la tyrannie se reproduit dans la nuit. »
Il est possible de continuer pendant des centaines de pages sur la pose et l’expression de la figure du martyr (et plus que quelques historiens de l’art l’ont fait), mais le 3 mai est l’une des rares peintures dans lesquelles presque chaque carré Remarquez, par exemple, la courbe scintillante du sabre d’un soldat français – un détail mineur de cette vaste toile qui pourtant, selon Hughes, surclasse pratiquement tout dans la peinture européenne de l’époque avec sa «spontanéité inspirée». Belle mais obsolète, l’arme se balance inutilement à la hanche de son propriétaire, symbole du faux romantisme de la guerre, dont Le 3 mai est lui-même la réfutation ultime. Malraux, pour sa part, a porté son attention sur le paysage urbain lointain et désespéré du tableau, lié au premier plan par une longue chaîne de prisonniers à peine visible au-dessus de la tête des soldats français. «Sans peindre les ruines», écrit-il, Goya «évoquait les fantômes des villes; personne d’autre n’a atteint cet objectif. »